Le premier chapitre (« Une France éclatée ») nous apprend que les violences urbaines seraient une « spécificité française » (sic). Des « cités interdites » sont présentées sous un jour peu avenant : des caïds tiennent le quartier (par exemple en vendant des logements vacants avec la garantie d’en interdire l’accès aux forces de l’ordre, p. 55). Ces quartiers sont d’autant plus interdits aux forces de l’ordre que dans le même temps, les préfets, obnubilés par la peur de la bavure et son écho médiatique, n’osent pas intervenir à chaud.
Le tableau ne serait pas complet sans un mot sur « l’école, apprentissage de la délinquance », où les rackets, le vandalisme massif, les enseignants et surveillants molestés, giflés en plein cours, les incendies volontaires, les chasses à l’homme pendant les récréations (liste raccourcie…) sont vus par l’auteur comme des phénomènes « banals » (p. 59). Patientons encore un peu pour les critiques…
Les trois chapitres suivants se présentent en forme de mise au pilori des acteurs du champ « Que fait la police ? », « Que fait la justice ? et « Que font les politiques ? ». Alors, que peut bien faire tout ce beau monde ?
La police d’abord (chapitre II), dont Georges Fenech estime qu’elle éprouve un découragement légitime face aux multirécidivistes, ce qui expliquerait le faible taux d’élucidation des crimes et délits (65% en 1965 à 23,40% en 1999). On apprend ensuite que la police essuie les feux croisés des délinquants d’un côté, de leur propre autorité hiérarchique de l’autre. La justice se montrerait de surcroît de plus en plus intraitable avec eux, sachant que « la moindre bavure peut aujourd’hui les conduire directement en prison » (p. 82). On ne peut ici s’empêcher de préciser que le contrôle et les éventuelles déviances de l’activité policière sont loin de faire l’objet d’une si grande sévérité (2) , mais essayons de contenir nos critiques pour le moment…
L’auteur pose cependant, me semble-t-il, une question légitime (en voilà au moins une…) : « Où est passée la police urbaine ? ». Depuis que les maires ont perdu tout pouvoir sur leur police après la seconde guerre mondiale, les préoccupations locales passent au second plan au profit d’une conception centralisée de la sécurité et du maintien de l’ordre public. Il regrette que les polices municipales constituent un « vivier inexploité », les maires étant ceux qui savent le mieux, ou le moins mal, ce qui se passe dans leur commune (p. 237). Il estime aussi que la police de proximité a engendré des « espoirs déçus », et dénonce « la paix achetée » par le recrutement de 20.000 adjoints de sécurité.
En ce qui concerne la justice (chapitre III), Georges Fenech s’en prend au « lobby de l’insécurité (3) » , porteur d’une « idéologie du tout permissif », qui résisterait farouchement à la reforme de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante (4), et serait responsable des nombreuses peines non exécutées et autres libérations conditionnelles (on trouve par exemple récit d’un croustillant cas de récidive suite à une remise en liberté conditionnelle, p. 174). Sur ce thème, Georges Fenech dénonce le fait que si les hommes politiques doivent de plus en plus répondre de leurs actes devant la justice, il regrette que ce ne soit pas le cas des magistrats, considérant la sacro-sainte indépendance de la magistrature comme source d’ « irresponsabilité absolue ».
L’auteur dénonce enfin la « justice light » (représentée par les maisons de justice et de droit), le manque de moyens et le taux très élevé de classements sans suite, au sujet duquel il parle de « déni de justice ». Il appelle à la généralisation de la comparution immédiate afin de donner plus de lisibilité à la « réponse sociale », et de lutter contre le découragement des forces de police.
Et les politiques (chapitre IV), que font-ils ? Ils écrivent des rapports (depuis 1977 et le rapport d’Alain Peyrefitte « Réponses à la violence », le rythme s’accélère…), multiplient les conseils (conseil national, départementaux, et communaux de prévention de la délinquance) et autres structures administratives (comité interministériel de la ville, fond social urbain, délégation interministérielle à la ville, puis ministère de la ville), mettent au point des plans (plans Delebarre, Tapie, Bartolonne, etc.) avec une similitude de diagnostics et de solutions. L’auteur ironise ensuite sur les « recettes miracles » que constituent les contrats locaux de sécurité (CLS) et la police de proximité dont les bilans lui semblent pour le moins mitigés.
Aux rayons des reproches, il regrette d’abord « l’aveuglement des politiques de droite comme de gauche » qui cherche à « dissiper la réalité d’une situation explosive » à tel point que le chiffre noir de la délinquance prenne des « allures de secret d’Etat » (pp. 216-217) ; puis la « distribution d’argent » des politiques de la ville qu’il voit comme un encouragement à la violence ! Rien que ça…
Un passage intéressant évoque les « nouveaux professionnels de la paix publique ». Ces correspondants de nuit, de quartier, médiateurs sociaux, agents d’ambiance, etc., armés de leur seule force de persuasion (car dépourvus de moyens légaux de contrainte), participent à leur façon à une mission de service public en tentant d’anticiper les situations de crise, de dénouer des conflits. En réinvestissant un pan entier de l’espace public laissé vacant par les forces de police, ils symbolisent le système de la débrouille avec un semblant de légitimité. Leur objectif n’est pas le maintien de l’ordre public, mais plus en amont le maintien de l’ordre social (p. 230).
Pour terminer, l’épilogue (« Les journées des dupes ») ironise sur le colloque de Villepinte d’octobre 1997, renvoyant dos à dos les responsables politiques (« les beaux engagements et les belles paroles »), et « déclare la guerre à la délinquance de voie publique » (p. 253). Georges Fenech appelle à la lutte contre le « lobby de l’insécurité » qui continue à œuvrer, entretenant une culture de l’excuse et culpabilisant les agents de répression…
Nous en voilà quitte pour l’essentiel du contenu de ce livre. Désolé mais on n’a pu s’empêcher de glisser ça et là quelques remarques critiques dans la première partie de cette note, la tentation était trop forte ! Mais c’est maintenant que l’on se propose d’aborder de manière plus explicite nos critiques. Avouons le, l’exercice est difficile, il convient d’être méthodique tant cet ouvrage se prête parfaitement au jeu… On retiendra deux grandes familles de critiques : appelons-les le sensationnalisme (qui s’attache plus à la forme), et les démonstrations douteuses (qui traitent davantage du fond), même si Georges Fenech imbrique à merveille ces deux dimensions.
La première grande critique, qui transpire déjà dans les lignes précédentes, est une tendance certaine aux envolées lyriques, au sensationnalisme et à l’exagération. On ne saurait citer l’ensemble des passages concernés, bien trop nombreux. Contentons-nous de quelques exemples révélateurs de l’effet impressionniste recherché par l’auteur (5). Ainsi, d’abord, quand l’auteur fait référence aux gros fournisseurs de drogue qui « élèvent » des enfants de moins de 13 ans (car ils ne risquent pas la détention), « comme ils dresseraient un chien », à apprendre à se taire et à endurer les gardes à vue, en les enfermant des nuits entières dans des caves, attachés, les privant de nourriture et les tabassant…(p. 56). Ensuite lorsque Georges Fenech présente l’école comme le lieu « d’apprentissage de la délinquance », où les phénomènes soient disant « banals » font déjà frémir (voir plus haut). On craint alors le pire quand il est question de ceux « moins fréquents mais réels », « enseignants molestés en classe par des individus en cagoule, attentat au cocktail Molotof ou même à la bombe dans l’établissement, (...) élève torturé, insurrection scolaire ou émeute durant les cours » (p. 60). Cela se passe de commentaire… Dernier exemple à propos des adjoints de sécurité (ADS) recrutés par la police, « on racle les fonds de tiroir, l’enquête de moralité est bâclée, et on se retrouve avec de plus en plus de délinquants dans nos rangs. (…) Certains de nos commissariats se sont retrouvés avec des délinquants envoyés par les grands frères pour faire la collecte de renseignements » (pp. 108-111). La tentation est grande de continuer la liste, tant ces lignes prêtent à sourire… mais ce sourire n’est pas sans susciter le questionnement. L’auteur joue à nous faire peur et semble prendre un malin plaisir à la fois à noircir le tableau, et à le diaboliser ; mais que gagne l’auteur à stigmatiser à ce point ces quartiers (« les cités aux rues jonchées de voitures calcinées, d’abribus saccagés, de commerces désertés », p. 19) ? ou la situation d’ensemble (« jamais notre pays n’a été confronté à un tel péril intérieur, (…) et rien n’est entrepris pour enrayer cette remontée vers la nuit mérovingienne », p18) ? N’y a t-il pas là-dessous une dimension politique et polémique inhérentes à sa position de responsable syndical (minoritaire, la précision nous semble d’importance), notre homme chercherait-il à se faire une place sur la scène professionnelle en pratiquant la surenchère ? Règlerait-il des comptes ?
Une autre critique découle implicitement de la précédente, toujours dans cette première famille de critiques, à savoir une tendance à la caricature. Déjà la forme du livre s’y prête : de nombreux sous-titres, souvent évocateurs (« Des cités interdites », « L’école, apprentissage de la délinquance », « Le lobby de l’insécurité », etc.), ne comprenant que quelques paragraphes pour certains. Cette structure privilégie le raccourci, la caricature et le sensationnel, au détriment de la profondeur d’analyse. La tendance à la caricature dont fait preuve l’auteur s’exprime parfaitement, sur le fond, à deux occasions au moins : d’abord lorsqu’il oppose la France, où tout va mal (les violences urbaines seraient une spécificité française…) à d’autres pays, parfois l’Angleterre, souvent les Etats-Unis, qui seraient exemplaires et nous montreraient le chemin. Or, on sait que la violence ou la criminalité sous toutes ces formes se situe aux Etats-Unis sur une échelle qui n’a rien à voir avec la situation française (6) , et que l’Angleterre connaît de sérieux problèmes récurrents d’émeutes urbaines impliquant les communautés ethniques (7).
La caricature est également à l’œuvre lorsque Georges Fenech oppose deux camps ennemis, l’un répressif dont il se réclame explicitement, l’autre préventif, responsable de tous les maux, ce fameux « lobby de l’insécurité » diffusant une « culture de l’excuse », qui serait très présent dans les médias et les allées du pouvoir. Cette dichotomie du « eux » versus « nous » entretient par ailleurs un sentiment prégnant de victimisation, « le juge d’instruction n’en finit pas de susciter la vindicte des puissants (…) un procès en sorcellerie, depuis 20 ans, accuse le juge d’instruction de porter atteinte aux libertés individuelles en incarcérant abusivement, de pratiquer la culture de l’aveu et la torture morale et d’être responsable du surpeuplement des prisons » (pp. 176-180).
La deuxième grande famille de critiques renvoie aux multiples démonstrations douteuses que l’on rencontre à la lecture de l’ouvrage. Là encore, les exemples sont nombreux. Ainsi en évoquant l’embrasement du quartier de Lille sud en avril 2000 suite à la mort du jeune Riad Hamlaoui (p. 113), Georges Fenech y voit un camouflet pour la police de proximité, qui est « censée régler le problème de la criminalité urbaine (8) » . On retrouve la même logique à propos des émeutes du quartier du Mirail à Toulouse en décembre 1998 pour appuyer sa thèse de l’échec des CLS. Comment ignorer à ce point le facteur déclenchant que représente un incident aussi singulier que dramatique (la mort controversée d’un jeune suite à une intervention policière) ? Argumentation aussi hasardeuse à propos du « chiffre noir de la délinquance urbaine » qui prend des « allures de secret d’Etat » vers l’été 2000 car « n’oublions pas que, trois ans plus tôt, la mise en place des fameux CLS et de la police de proximité était censée régler tous les problèmes » (p. 217). Or, considérer que la police de proximité a été mise en place en 1997 est bien hasardeux, et lui attribuer la responsabilité de « mauvais chiffres » l’est tout autant. Quelques précisions s’imposent : 1997 correspond en fait juste au lancement de quelques expérimentations, et c’est le Conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1999 qui lance le développement d’une police de proximité, qui sera effective sur une période de trois ans sur l’ensemble du territoire national, en juin 2002. Par ailleurs, notons que la réforme de la police de proximité peut très bien entraîner une augmentation des chiffres de la délinquance en raison de la proximité des nouveaux postes de police, leur disponibilité (horaires d’ouvertures élargies) et la visibilité et donc l’accessibilité des policiers sur le terrain. En outre, le caractère préventif de cette police ne saurait l’exposer à des attentes de résultats immédiats. Voilà qui fait beaucoup d’approximations…
Autre exemple d’argumentation bancale : l’auteur réfute avec force l’idée selon laquelle la misère serait une cause du crime et les rebellions collectives une manifestation d’injustices sociales. Mais il fait encore plus fort en soutenant l’idée selon laquelle le chômage serait une conséquence directe de l’insécurité et non sa cause, « ainsi quand une grande surface de distribution devient la cible régulière d’émeutiers et de pillards, et qu’aucune compagnie d’assurances n’accepte plus de couvrir ce genre de risque, elle tire ses rideaux et met ses employés à la porte » (p. 159). Un tel argumentaire laisse songeur… Ne se rapprocherait-on pas de la malhonnêteté intellectuelle ou de la mauvaise foi ?
Dans cet ordre d’idées, on ne peut passer sous silence son quasi acharnement vis-à-vis du syndicat de la magistrature, inclus dans le fameux « lobby de l’insécurité » (surtout pp. 160-164), à qui il reproche notamment de « violer l’obligation de réserve qui s’impose statutairement à la magistrature » puisqu’il estime que le fait syndical devrait juste être fondé sur le principe de la seule défense des intérêts moraux et matériels de la profession, or Georges Fenech n’est-il pas lui-même magistrat et même responsable syndical (annoncé en dos de couverture) !!?!…
Enfin, l’auteur n’en est pas à une contradiction près lorsqu’il encense un dispositif de correspondants de nuit à Rennes (qui contribue apparemment à faire reculer le sentiment d’insécurité, p. 228), alors qu’il a « incendié » quelques pages auparavant les CLS et le dispositif emploi-jeune (pp. 210-215). Ou encore, ce sous-titre (« Tolérance zéro à l’école primaire », p. 238) qui développe des faits divers survenus en collèges et lycées ! probablement parce que plus croustillants… Outre cette énormité plus risible qu’autre chose, il convient d’apporter un sérieux bémol au tableau bien noir que propose l’auteur sur la délinquance à l’école (9).
Terminons nos critiques en mettant en cause quelques sources sur lesquelles s’appuie l’auteur. D’abord, les chiffres cités, dont l’origine est rarement claire, et avec lesquels Georges Fenech prend peu ou pas de précautions. Ensuite, Alain Bauer, souvent cité, n’est peut-être pas « l’expert » le plus légitime ni le plus scientifique du champ (10). Quant à la grille d’évaluation de la dangerosité des quartiers établie par les Renseignements Généraux (RG) et utilisée ici pour argent comptant, on dira simplement qu’elle mesure avant tout les troubles à l’ordre public et les tensions entre jeunes et police, plutôt que l’ensemble des crimes et délits dont la population pourrait être victime (11). On l’aura compris, il nous a fallu plus d’efforts pour dégager des passages dignes d’intérêt que de regretter la somme de motifs d’insatisfaction liés à la démarche de l’auteur, bien plus idéologique que scientifique.
En tout cas, au regard des dérives idéologiques dont nous avons mis au jour un aperçu, on tient ici un beau specimen, bien placé pour décrocher le statut d’idéal-type !
Damien Cassan
Notes
(1) L’auteur y fait plusieurs fois référence. Il cite les auteurs à l’origine de cette doctrine (Wilson J.Q, Kelling G, « Broken Windows », The Atlantic Monthly, march 1982, pp. 29-38) selon laquelle si une vitre brisée n’est pas remplacée, toutes les autres vitres risquent rapidement de connaître le même sort. Il faut donc répondre à chaque acte de délinquance, le plus minime soit-il.
(2) On pense par exemple à la communication de Monjardet (D.) « La commission nationale de déontologie de la sécurité : premier rapport, 2001 », présentée au séminaire « Questions de police » du GERN consacré au contrôle des polices le 5 et 6 avril 2002 à la MSH à Paris. Voir aussi Jobard (F.), Bavures policières ? La force publique et ses usages, Editions La Découverte, « Textes à l’appui », Paris, 2002 (notamment p. 13).
(3) Ce lobby serait constitué, pour l’auteur, de l’association française des magistrats de la jeunesse, la CFDT Justice / PJJ, la CGT pénitentiaire, le Syndicat de la magistrature, la ligue des droits de l’homme, le SNPES, la PJJ (p. 141).
(4) L’ouvrage est antérieure à cette réforme intervenue en 2002.
(5) Voir déjà l’iconographie de la page de couverture, une scène de guérilla urbaine, des jeunes encagoulés (aux cheveux foncés et frisés…) lançant des pierres…
(6) Landreville (P.), « Va-t-on vers une américanisation des politiques de sécurité en Europe ? », in Mucchielli (L.) et Robert (P.), Crime et Sécurité, l’état des savoirs, La Découverte, « Textes à l’appui », Paris, 2002, pp. 424-433 ; ou Roché (S.), « La tolérance zéro est-elle applicable en France ? », in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 34, 4ème trimestre 1998, pp. 203-232.
(7) Voir Le Monde du 30 mai 2001, p. 2.
(8) Alors qu’elle est le résultat d’une action d’une brigade canine n’ayant aucune connaissance du terrain, ce qui va à l’encontre de l’interprétation de l’auteur. Cf Duprez (D.), Body-Gendrot (S.), « Les politiques de sécurité et de prévention dans les années 1990 en France », Déviance et société, 2001, 25, n°4, p. 392.
(9) Voir Debarbieux (E.), « L’école face à la délinquance », in Mucchielli (L.), Robert (P.), Crime et Sécurité, l’état des savoirs, La Découverte, « Textes à l’appui », Paris, 2002, pp. 337-346, notamment p. 342.
(10) Mucchielli (L.), Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, « Sur le Vif », Paris, 2001, voir pp. 32-33 notamment.
(11) Mucchielli (L.), Violences et insécurité, op cit, p. 42.
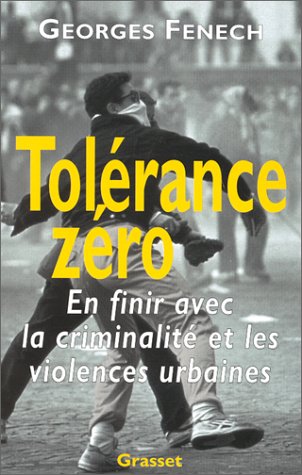 Acheter cet ouvrage en ligne
Acheter cet ouvrage en ligne